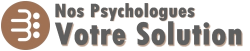Dans les regards des jeunes d’aujourd’hui, une inquiétude sourde s’est installée. Elle n’est pas toujours exprimée, parfois même refoulée, mais elle est bien là — persistante, profonde, difficile à apaiser. Cette inquiétude porte un nom : l’éco-anxiété. Elle n’est pas un simple malaise passager ou une réaction émotionnelle excessive. Elle est le reflet d’un mal-être réel, enraciné dans la conscience croissante de la gravité de la crise environnementale. Et plus que jamais, elle témoigne d’un rapport abîmé entre la jeunesse et son avenir.
L’éco-anxiété se manifeste comme une peur chronique de l’effondrement écologique, une angoisse de vivre dans un monde en sursis, où l’air, l’eau, les forêts et les espèces vivantes disparaissent, souvent sans retour. Ce n’est pas un trouble psychiatrique au sens traditionnel du terme, mais plutôt une forme d’angoisse existentielle, exacerbée par une exposition constante à des informations alarmantes sur le climat, les incendies, les sécheresses, les extinctions de masse ou les catastrophes naturelles. Une forme de lucidité douloureuse, qui fragilise profondément la santé mentale de toute une génération.
Pour beaucoup de jeunes, cette anxiété ne se limite pas à une inquiétude pour l’environnement. Elle touche tous les aspects de la vie : la construction de projets, le choix d’une carrière, l’idée même de fonder une famille. Comment se projeter dans un monde que l’on pense condamné ? Comment croire en demain quand les rapports scientifiques évoquent l’irréversibilité de certaines crises ? Ce climat d’incertitude extrême transforme l’éco-anxiété en symptôme d’un avenir dérobé — d’un futur que l’on aurait dû pouvoir rêver, mais qui semble désormais compromis.
Cette souffrance est d’autant plus difficile à vivre que, bien souvent, elle est incomprise. Les adultes la minimisent, les institutions n’en parlent pas, les médias la transforment parfois en caricature. Il arrive que l’éco-anxiété des jeunes soit perçue comme une sensibilité excessive, une forme de « pessimisme à la mode ». Mais il ne s’agit pas d’une crise passagère. Il s’agit d’une détresse enracinée dans des faits, alimentée par un réel sentiment d’impuissance face à l’inaction collective. La jeunesse n’est pas « trop sensible », elle est très lucide.
Et cette lucidité a un coût : troubles du sommeil, stress chronique, perte d’estime de soi, repli social, sentiments de culpabilité ou de colère. Chez certains, cela peut aller jusqu’à des états dépressifs ou des idées noires. Dans un monde où les jeunes sont déjà confrontés à des défis économiques, sociaux et identitaires, l’angoisse écologique ajoute une pression supplémentaire, invisible mais massive.
Pourtant, face à cette souffrance, tous ne sombrent pas. Chez beaucoup, l’éco-anxiété devient moteur d’engagement. Des milliers de jeunes rejoignent des mouvements écologistes, créent des projets, interpellent les dirigeants, participent à des actions concrètes pour défendre la planète. Cet engagement peut être salvateur, car il redonne un sentiment de pouvoir d’agir, un cadre collectif, un objectif commun. Mais il peut aussi s’accompagner d’un autre poids : la fatigue militante, le découragement, la sensation de porter seuls un combat qui devrait être universel.
Alors, que faire ? D’abord, reconnaître. Nommer l’éco-anxiété, c’est commencer à la légitimer. Il est essentiel que les institutions éducatives, les professionnels de santé, les médias et les familles comprennent qu’il ne s’agit pas d’un phénomène marginal, mais d’une souffrance générationnelle bien réelle. Ensuite, écouter. Créer des espaces de dialogue, où les jeunes peuvent exprimer leurs émotions sans jugement, est une nécessité. Enfin, agir. Lutter contre l’éco-anxiété ne passe pas seulement par un soutien psychologique, mais aussi — et surtout — par une réponse politique, sociale et écologique cohérente.
Les jeunes ont besoin de sentir que leur angoisse est entendue, que leurs alertes sont prises au sérieux, que des actions concrètes sont engagées. Ils ont besoin de savoir qu’ils ne portent pas seuls le poids du monde. Redonner confiance en l’avenir ne se décrète pas — cela se construit, pas à pas, dans un climat de responsabilité partagée.
L’éco-anxiété n’est pas un dysfonctionnement. C’est une réaction humaine face à une crise réelle. C’est un cri silencieux, qui dit l’amour du vivant, la peur de perdre ce qui reste, et l’envie farouche de préserver ce qui peut encore l’être. L’écouter, c’est faire preuve de respect. Y répondre, c’est faire preuve de courage.